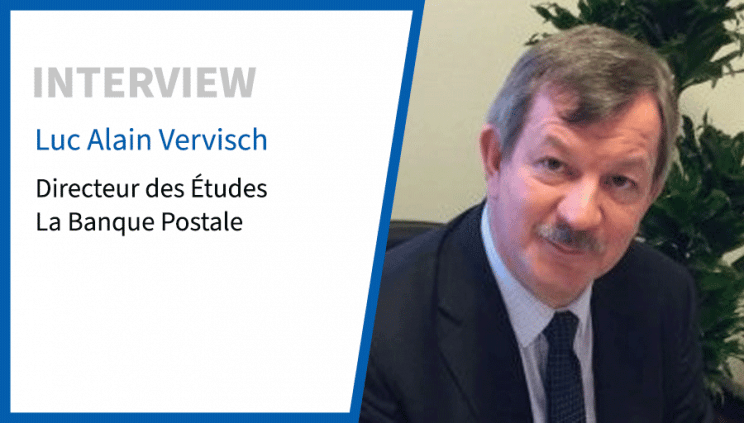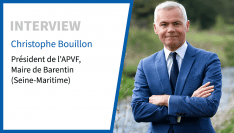Le concept de gouvernance est très à la mode. Peut-on dire selon vous que les administrations locales participent à la gouvernance financière du pays ?
À la gouvernance, je ne sais pas ; à la maîtrise, certainement. Le principal vecteur de l’implication des collectivités territoriales dans ce domaine passe par ce qu’on appelle la « règle d’or » : le fait que leurs emprunts ne peuvent financer que des dépenses d’investissement, qui enrichissent leur patrimoine, ou éventuellement celui des collectivités qui leur sont proches ; et le fait que ces emprunts doivent être remboursés par des ressources propres, à savoir pour l’essentiel l’autofinancement. Si l’on y ajoute la règle de l’équilibre budgétaire qui exige que les recettes prévisionnelles soient égales aux dépenses anticipées, et que tout déficit comptable doit être couvert dès l’année qui suit sa constatation sauf cas particulièrement sérieux, on a là un système qui garantit en principe une maîtrise des comptes locaux et une relative maîtrise de la dette locale.
Le système vous semble toutefois incomplet. Pourquoi ?
Dans deux domaines, ces dispositions n’ont pas empêché les collectivités locales de faire évoluer dans des proportions importantes à la fois leurs ressources fiscales, dont la plupart étaient encore, avant 2019, modulables de façon relativement libre, et leurs dépenses, en particulier – au moins avant 2015 – leurs charges courantes – dont une partie est au demeurant dépendante des règles adoptées par l’État lui-même, qu’il s’agisse des dépenses sociales ou des dépenses de personnel par exemple, ou encore de l’impact de normes parfois assez contraignantes.
À titre d’illustration, je me contenterai de citer l’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui reste aujourd’hui l’impôt local le plus important : son produit a été multiplié par trois au cours des vingt dernières années.
Or, ces tendances se sont de plus en plus inscrites en opposition aux orientations nationales relatives à une diminution de la pression fiscale. Bref, on ne peut pas vraiment parler de « gouvernance financière partagée » : et de ce fait, quand l’État prend pour réduire sa dette des mesures qui impactent les ressources locales, comme avec la baisse des dotations entre 2014 et 2017, il le fait de façon unilatérale (ce qui est, d’ailleurs, parfaitement son droit).
On a parfois le sentiment que la dette nationale sert à renflouer les caisses des administrations locales. Comment l’expliquer ?
Comme je l’ai dit, la règle de l’équilibre budgétaire exige que les recettes prévisionnelles soient égales aux dépenses anticipées, et que tout déficit comptable doit être couvert dès l’année qui suit sa constatation sauf cas particulièrement sérieux.
Or, pour financer leurs actions, les administrations locales n’ont pas hésité au cours du temps à augmenter les impôts locaux alors même que ceux-ci ont présenté des défauts structurels : obsolescence progressive des bases d’imposition, déconnexion des contributions avec les capacités des contributeurs… Ces défauts sont devenus avec le temps si importants que la solution adoptée à maintes reprises, faute d’imagination collective, n’a pu être que celle de la suppression partielle ou totale de certains impôts locaux, compensée par des versements de l’État. Ce qui est revenu dans les faits à aggraver son déficit propre. Façon inattendue de détourner la règle d’or, puisque cela revient en fait à faire financer une part des dépenses courantes locales par la dette nationale.
Quels leviers l’État a-t-il jusqu’à présent actionnés pour maîtriser les dépenses décentralisées ?
Face à cette situation, l’État a été conduit à réduire progressivement le poids des engagements qu’il avait pris auprès des collectivités locales et qui se traduisaient par le versement de dotations sous diverses formes. Dans un premier temps, en décorrélant leur évolution de celle de la croissance économique nationale ; puis, en stabilisant en valeur l’essentiel des enveloppes financières ; enfin, entre 2014 et 2017, en réduisant de 11,5 milliards d’euros la plus importante de ses dotations, ceci n’étant qu’un des éléments du programme de stabilité que la France avait présenté aux institutions européennes avant 2014.
L’État a ensuite voulu imposer aux collectivités locales une maîtrise de leurs dépenses courantes, en limitant leur progression annuelle à 1,2 % en moyenne entre 2017 et 2019 ; ceci a pris la forme de contrats signés avec les 321 plus importantes collectivités, représentant ensemble plus de la moitié des dépenses locales ; et même, pour les collectivités refusant de signer un contrat, la forme de décisions prises dans les départements par le préfet et s’imposant à ces dernières.
Mais force est de reconnaître que si cette contrainte a été efficace, c’est aussi que les collectivités s’étaient elles-mêmes engagées dans de véritables efforts de pilotage de leurs dépenses, notamment en matière d’achats et de salaires ; démarches locales et prescription nationale se sont donc trouvées correspondre au même moment.
La vraie question serait d’ailleurs de savoir s’il est légitime, dans un État décentralisé, que l’État souhaite assumer la maîtrise que vous dites ; mais en fait, ce sont moins les dépenses locales qu’il veut piloter que la dette locale, car celle-ci est un élément de la dette nationale et qu’il ne parvient guère à maîtriser sa propre part.
Il faudra bien se poser la question de la légitimité des exigences de l’habitant quand il n’en assume pas le prix.
Pourquoi les efforts menés par l’État pour maîtriser la dette locale vous semblent-ils insuffisants, voire contreproductifs ?
Le paradoxe est que dans un premier temps, la diminution des dotations versées aux collectivités locales s’est traduite par une baisse de leurs investissements – alors qu’elles assurent plus des deux tiers de l’investissement public civil – se traduisant par une dégradation désormais manifeste d’une partie du patrimoine ; et que dans un second temps, si la maîtrise de leurs dépenses a permis de dégager un autofinancement qui atteignait en 2019 un record historique, ceci n’a pas eu pour effet de réduire le recours à l’emprunt mais, au contraire, de commencer à compenser en investissement le retard pris les années précédentes.
Bref, si l’enjeu implicite de ces mesures était d’obtenir une diminution de la dette locale comme élément d’une diminution de la dette française, force est de reconnaître qu’il n’a pas été atteint. Il faut en effet comprendre que la dette locale est assez assimilable à celle d’un ménage raisonnable ; on emprunte pour se constituer un patrimoine, et on emprunte d’autant plus qu’on a les moyens de rembourser plus. En bref, un autofinancement croissant, c’est assez souvent une incitation à une dette en augmentation.
Vous plaidez pour une République unitaire « coopérative » car il faut selon vous créer de nouveaux outils de programmation collective des investissements et des dépenses au niveau national. De quoi s’agit-il ?
Trois pistes d’évolution existent selon moi pour associer – et non plus contraindre ! –, les collectivités locales à assumer leur part de la soutenabilité des comptes publics.
La première, en réflexion au sein de l’État, passe par une nouvelle contractualisation qui ne se fonderait pas seulement sur un objectif chiffré d’évolution des dépenses, surtout dans un contexte inflationniste changeant, mais examinerait d’abord la réalité des besoins locaux et traduirait concrètement, tant au regard des moyens (humains, logistiques, patrimoniaux) que des objectifs, l’effet des efforts envisagés sur la qualité des services publics fournis localement. Ce serait un progrès réel vers une généralisation de l’évaluation des politiques publiques, qui reste dans notre pays à l’état d’ébauche.
La deuxième, moins facilement acceptable, serait de faire des impôts nationaux partagés au bénéfice des collectivités locales, qui représentent désormais environ 60 milliards d’euros, soit un quart de leurs recettes courantes, un outil de discussion commune avec l’État, à la fois en termes de niveau de pression fiscale et en termes de modalités de répartition. Le système actuel, dans lequel l’État pourrait être incité à jouer sur les taux de TVA sans conséquences majeures pour son budget puisqu’il ne conserve désormais même pas la moitié de son produit, et où la répartition entre bénéficiaires est figée par référence à des situations historiques, ne nous paraît pas viable à terme.
La troisième enfin, qui porterait à la fois sur les investissements et sur la dette, reviendrait à convenir de façon concertée des objectifs que la Nation pourrait se fixer à moyen terme, notamment pour répondre aux nécessités de la transition écologique et aux ambitions de réindustrialisation, et aux modalités de financement correspondantes. Une telle méthode pourrait parfaitement, d’ailleurs, être appliquée aux différents niveaux locaux (territoires régionaux, départementaux, intercommunaux…), et peut-être même faudrait-il commencer par là. Explorer ces solutions serait de mon point de vue un moyen de donner un nouvel élan à la décentralisation, au sein d’une République unitaire mais coopérative.
Comment les collectivités locales peuvent-elles absorber l’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières selon vous ?
La situation fin 2021 semble permettre globalement d’absorber les effets de l’inflation (et aussi l’augmentation des traitements de la fonction publique, mais aussi des salaires dans le secteur social, médico-social et non lucratif). En outre, l’inflation a paradoxalement un effet positif inattendu : la part de TVA versée aux régions, aux départements, à la plupart des EPCI et à la ville de Paris, va augmenter en 2022 bien plus que prévu. La vraie question, pour l’ensemble du monde local, me semble être celle de la durabilité de la pression inflationniste, parce qu’on ne mange son pain blanc qu’une fois ; et, pour les communes, qui vont subir le plus fortement l’augmentation des prix en 2022, celle de la remise en cause de services et d’équipements publics peut-être désormais incompatible avec leurs capacités financières… d’autant plus que l’habitant n’étant parfois plus un contribuable puisque la taxe d’habitation a été supprimée, il faudra bien se poser la question de la légitimité de ses exigences quand il n’en assume pas le prix.
Propos recueillis par Fabien Bottini, Consultant, Professeur à l’Université du Maine, Membre de l’IUF






![[ép. 184] Que retenir de la DGF 2024 ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2024/04/ep-184-que-retenir-de-la-dgf-2024-300x161.png)