Nos Solutions
Un écosystème complet, digital et interactif au service des acteurs publics : ressources opérationnelles et méthodologiques, assistance téléphonique sur-mesure, masterclasses, veille juridique, préparation au concours...
Les offres Weka Intégral
Un accès à l’ensemble des contenus de votre thématique préférée, parmi plus de 10 000 fiches et 6 000 outils, couplé à un support téléphonique pour toutes vos questions juridiques.
Weka Ligne Expert
Votre service d’échanges téléphoniques avec les experts du secteur public.
Des échanges illimités pour des coûts optimisés et un budget maîtrisé.
Weka Smart
Des cycles de Masterclasses incluant des sessions live et une plateforme complète pour professionnaliser vos pratiques, vous adapter aux nouveaux contextes juridiques et sécuriser vos actions et vos décisions.
Weka Le Mag
Le magazine proche des acteurs à l'oeuvre dans les territoires. WEKA le mag, vous partage les retours d'expériences, l'actualité et décrypte les projets d'innovation publique.
Nos univers thématiques pour répondre à la diversité des métiers de la fonction publique et vous accompagner sur l’ensemble des compétences du secteur public.
WEKA propose des fiches pratiques fiables et faciles d’utilisation et des outils prêts à l’emploi : à chaque problématique, une méthodologie simple et efficace.
-
Les fiches et outils les plus consultés
-

L’obligation de verdissement des flottes de véhicules pour les ...
La présente fiche a pour objectif de préciser les modifications du Code de ... -
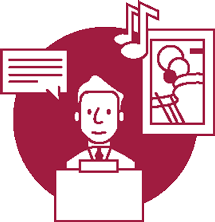
Se positionner vis-à-vis du directeur de cabinet
Le directeur de cabinet est très souvent identifié comme l’interface privilégiée ... -

Quelles fonctions le maire peut-il déléguer ?
À côté des délégations que le conseil municipal peut confier au maire, une autre ... -

Les attributions du chef d’établissement
Le métier de chef d’établissement a évolué vers une culture de l’encadrement ... -

Dynamiser la participation aux conseils de la vie sociale
Le décret n° 2022-688 du 25 avril 2022 a modifié la composition et les ... -

Élaborer un projet de service
Le projet de service peut être défini comme un processus collaboratif essentiel dans ...
-
-
Marchés publics
L'intégralité des contenus par sujet
-
Gestion des services publics
142 fiches et 55 outils
-
Code de la commande publique
1473 fiches et 3 outils
-
Prestataire
154 fiches et 94 outils
-
Publicité des marchés publics
12 fiches et 14 outils
-
Préparation du marché
155 fiches et 142 outils
-
Exécution du marché
219 fiches et 133 outils
-
Prix du marché public
41 fiches et 28 outils
-
Procédure de marché public
134 fiches et 68 outils
-
Offres au marché public
42 fiches et 26 outils
-
Type de marché
257 fiches et 276 outils
-
Maître d'ouvrage
56 fiches et 29 outils
-
Passation du marché
142 fiches et 91 outils
Les fiches et outils les plus consultés
-

Réaliser l’avant-projet (APS, APD) : construction neuve d’un ...
La mission de conception est décomposée en éléments portant sur l’esquisse, ... -

Comment procéder à la rédaction d’une lettre de rejet ?
-

Courrier de transmission des documents administratifs
-
-
Ressources humaines
L'intégralité des contenus par sujet
-
Agent
406 fiches et 292 outils
-
Gestion administrative
837 fiches et 636 outils
-
Management
509 fiches et 367 outils
-
Organisation de travail
216 fiches et 138 outils
-
Organisme lié aux RH
104 fiches et 52 outils
-
Rémunération
344 fiches et 190 outils
-
Statut
193 fiches et 45 outils
Les fiches et outils les plus consultés
-

Élaborer un projet de service
Le projet de service peut être défini comme un processus collaboratif essentiel dans ... -

Comment rédiger un mémoire en défense ?
Les contentieux en matière de personnel sont nombreux, car les agents n’hésitent plus ... -

La radiation des cadres dans la fonction publique
La radiation des cadres est la décision administrative qui constate la cessation ...
-
-
Action sociale
L'intégralité des contenus par sujet
-
Accompagnement des publics
233 fiches et 167 outils
-
Aides et politique sociale
220 fiches et 223 outils
-
Insertion
141 fiches et 107 outils
-
Petite enfance
58 fiches et 29 outils
-
Population
341 fiches et 180 outils
-
Structure sociale et médico-sociale
326 fiches et 198 outils
-
Traitement des résidents
149 fiches et 106 outils
Les fiches et outils les plus consultés
-

Dynamiser la participation aux conseils de la vie sociale
Le décret n° 2022-688 du 25 avril 2022 a modifié la composition et les ... -

Construire un livret d’accueil d’assistant maternel
Le métier d’assistant maternel manque parfois de lisibilité pour les futurs ... -

Élaborer le projet éducatif
Au même titre que le projet social, le projet éducatif fait partie du projet ...
-
-
Institutions et administration territoriale
L'intégralité des contenus par sujet
-
Collectivité territoriale
422 fiches et 163 outils
-
Délégation
45 fiches et 34 outils
-
Élu
84 fiches et 60 outils
-
État
15 fiches et 13 outils
-
Fonction publique
36 fiches et 8 outils
-
Organe délibérant
45 fiches et 26 outils
-
Registres
21 fiches et 20 outils
-
Administration électronique
42 fiches et 25 outils
Les fiches et outils les plus consultés
-

Les pouvoirs de police du maire : les troubles de voisinage
Alors que le « vivre-ensemble » suscite des débats de plus en plus passionnés, le ... -

Comment archiver ses documents administratifs ?
Du fait de son activité d’intérêt public, toute collectivité est amenée à prendre ... -

Modèle de lettre de refus d’attribution de subvention
-
-
Finances et comptabilité
L'intégralité des contenus par sujet
-
Gestion budgétaire
155 fiches et 162 outils
-
Gestion comptable
165 fiches et 173 outils
-
Gestion financière et fiscale
556 fiches et 329 outils
Les fiches et outils les plus consultés
-

Connaître les subventions du conseil régional
Collectivité territoriale porteuse de projet, vous souhaitez connaître l’étendue ... -

Les chapitres et articles budgétaires pour les budgets votés par ...
L’exécutif local ne peut dépenser que dans la limite d’autorisations budgétaires ... -

L’émission des titres de recettes
Le décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable, ...
-
-
Services à la population
L'intégralité des contenus par sujet
-
État civil
422 fiches et 397 outils
-
Funéraire
122 fiches et 83 outils
-
Vie locale et citoyenneté
721 fiches et 338 outils
-
Police, risques et sécurité
686 fiches et 403 outils
Les fiches et outils les plus consultés
-
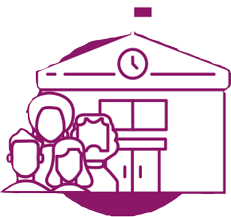
Comment établir le certificat de célibat ?
Le célibat est l’état d’une personne en âge d’être mariée mais qui ne l’est ... -
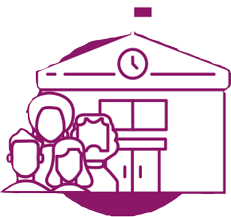
Procéder à l’audition des futurs époux dont l’un au moins est ...
L’audition des futurs époux, préalable à la publication des bans a pour but de ... -
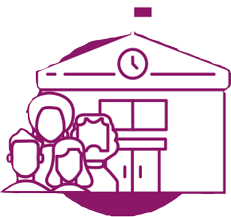
Être assesseur d’un bureau de vote
Chaque bureau de vote comprend au moins deux assesseurs devant obligatoirement être ...
-
-
Santé
L'intégralité des contenus par sujet
-
Médicament
124 fiches et 23 outils
-
Patient
120 fiches et 17 outils
-
Établissement de santé
119 fiches et 52 outils
-
Maladie
86 fiches et 31 outils
-
Professionnel de santé
355 fiches et 178 outils
-
Politique de Santé
248 fiches et 148 outils
-
Soins
184 fiches et 39 outils
-
Structure nationale de santé
98 fiches et 11 outils
Les fiches et outils les plus consultés
-

Qu’est-ce que la qualité des soins ?
La qualité des soins est définie par l’OMS comme la délivrance à chaque patient de ... -

Qu’est-ce que la responsabilité et quels sont les différents ...
Selon le professeur Cornu, « la responsabilité se définit comme ... -

Quelles sont les causes exonératoires de responsabilité civile ...
En droit de la responsabilité civile, on parle d’exonération lorsqu’une personne ...
-
-
Éducation
L'intégralité des contenus par sujet
-
Acteur de l'éducation
255 fiches et 254 outils
-
Établissement scolaire
137 fiches et 103 outils
-
Politique de l'éducation
274 fiches et 267 outils
-
Vie scolaire
167 fiches et 166 outils
Les fiches et outils les plus consultés
-

Être un chef (d’établissement), devenir un leader
Il ne suffit plus pour bien diriger d’être chef d’établissement. Il est souhaitable ... -

Les attributions du chef d’établissement
Le métier de chef d’établissement a évolué vers une culture de l’encadrement ... -

Maîtriser les risques comptables et financiers
Le contrôle interne est une notion issue du secteur privé. Il se définit comme un ...
-
-
Aménagement des territoires
L'intégralité des contenus par sujet
-
Infrastructures publiques et transports
295 fiches et 241 outils
-
Urbanisme et développement territorial
575 fiches et 297 outils
-
Environnement
342 fiches et 210 outils
Les fiches et outils les plus consultés
-

L’obligation de verdissement des flottes de véhicules pour les ...
La présente fiche a pour objectif de préciser les modifications du Code de ... -

Comprendre et mettre en cohérence les PLU, SCoT et autres documents ...
Le législateur a prévu différents documents d’urbanisme afin d’organiser le ... -

Réaliser un diagnostic de territoire : outils et méthodologie
Selon l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le diagnostic de ...
-
-
Culture et communication
L'intégralité des contenus par sujet
-
Culture
183 fiches et 139 outils
-
Communication
963 fiches et 342 outils
Les fiches et outils les plus consultés
-
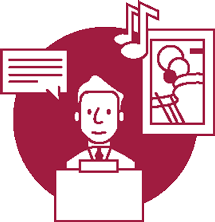
Décès d’un ancien maire de la commune
Un maire doit prononcer un discours à l’occasion d’un hommage rendu à l’ancien ... -
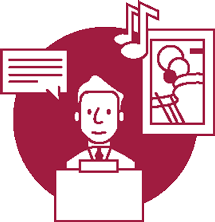
Comment accueillir un ambassadeur ou une personnalité étrangère ...
Une commune qui compte sur son territoire une communauté étrangère importante, qui ... -
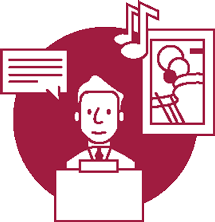
Se positionner vis-à-vis du directeur de cabinet
Le directeur de cabinet est très souvent identifié comme l’interface privilégiée ...
-
-
Les dernières actualités
-
 Article
Article
Exécution financière du marché
Comment aider les communes rurales face aux difficultés liées à l'obligation de facturation électronique ?
-
 Article
Article
Éducation
Éducation en Seine-Saint-Denis : les syndicats appellent à une nouvelle grève le 22 avril 2024
-
 Article
Article
Santé
Sauver les pharmacies dans les communes rurales
-
-
Prochaine(s) web-conférence(s)
AdministrationCybercriminalité : comment les collectivités peuvent-elles se protéger ?
jeudi 23 mai 2024
de 11h00 à 12h00
Weka TV :
Découvrez l’actualité en vidéos via nos programmes originaux.


[ép. 185] Gérer ensemble les deux cycles de l’eau : retour sur expérience
![[ép. 184] Que retenir de la DGF 2024 ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2024/04/ep-184-que-retenir-de-la-dgf-2024-300x161.png)

[ép. 184] Que retenir de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2024 ?
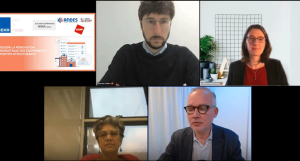

Comment réussir la rénovation énergétique des équipements sportifs structurants ?


