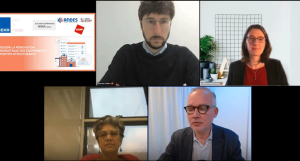Les agents non titulaires, aujourd’hui appelés les « contractuels », peuvent être dotés d’un contrat de droit privé, même s’ils travaillent dans la fonction publique et exercent un emploi public.
Ainsi, sont pourvus de contrats de droit privé :
- les assistants maternels (CASF, art. L. 421-1 et L. 423-17) et familiaux (CASF, art. L. 421-2 et R. 422-1), qui relèvent d’un double statut « public-privé », du fait qu’ils dépendent d’un agrément accordé par le président du conseil départemental, bien qu’ils soient recrutés en vertu, normalement, de contrats régis par le Code du travail (voir CASF, art. L. 421-1 à L. 423-35 et R. 421-1 à D. 423-27) ; leur contrat est de droit privé lorsque, par exemple, il est conclu avec une personne morale de droit privé chargée de la gestion d’un service public ;
- les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, visés par les 1° au 4° et 9° au 11° de l’article L. 5212-13 du Code du travail (CGFP, art. L. 326-1 et L. 352-1 à L. 352-6) ;
- les bénéficiaires des « contrats unique d’insertion » (C. trav., art. L. 5134-19-1 à L. 5134-19-5 et R. 5134-14 à R. 5134-24), sous forme de « contrats d’accompagnement dans l’emploi » (CUI-CAE) (C. trav., art. L. 5134-20 à L. 5134-34 et R. 5134-26 à R. 5134-50-3), en application du 1° de l’article L. 5134-19-3 du Code du travail ;
- les personnes, en difficulté sociale, bénéficiaires des contrats relatifs aux activités d’adultes-relais (C. trav., art. L. 5134-100 à L. 5134-109 et D. 5134-145 à D. 5134-160), des contrats « emploi avenir » (C. trav., art. L. 5134-110 à L. 5134-119 et R. 5134-161 à R. 5134-168) ;
- les apprentis (C. trav., art. L. 6211-1 à L. 6261-2 et D. 6211-2 à D. 6275-5) (cf. Recruter un apprenti).
Tous ces contrats, passés par des employeurs publics ou parapublics (personnes privées gérant un service public ou organisme de droit privé à but non lucratif, par exemple), sont des contrats de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée.






![[ép. 184] Que retenir de la DGF 2024 ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2024/04/ep-184-que-retenir-de-la-dgf-2024-300x161.png)