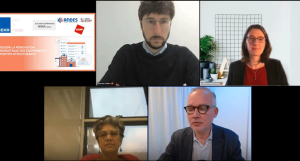L’organisation des études pharmaceutiques s’est progressivement restructurée au cours de ces dernières décennies, principalement de façon spécifique en regard de l’évolution des progrès de la médecine et corrélativement de l’évolution des traitements introduits par l’apparition de nouvelles molécules et de thérapeutiques innovantes.
Cependant, on ne saurait occulter d’autres éléments qui, bien que totalement étrangers aux spécificités de la discipline, ont néanmoins induit des évolutions notables en matière de déroulement des études pharmaceutiques.
Il en est ainsi du numerus clausus, disposition qui limite le nombre d’étudiants susceptibles de s’engager dans des études de pharmacie, et de l’instauration du système dit « LMD » introduisant 3 niveaux de formation : licence, master, doctorat, en application de directives européennes relatives à l’harmonisation des diplômes.
Par ailleurs, et au-delà des adaptations portées à la nature et au volume des enseignements, cette restructuration a également affecté les modalités d’accès à ces études ainsi que les modalités de sélection au terme de la 1re année.
Un rapide rappel des évolutions les plus marquantes en la matière permettra de mieux appréhender l’organisation actuelle des études pharmaceutiques.






![[ép. 184] Que retenir de la DGF 2024 ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2024/04/ep-184-que-retenir-de-la-dgf-2024-300x161.png)