Mesdames, messieurs,
Nous sommes heureux de vous accueillir à cette réunion d’information et ravis de constater que vous êtes nombreux, intéressés par l’initiative que nous vous proposons.
De quoi s’agit-il ? De mettre en place, dans notre quartier, une association pour le maintien d’une agriculture paysanne. Vous en connaissez certainement mieux l’acronyme : AMAP. Concrètement, une AMAP consiste en un partenariat de proximité...

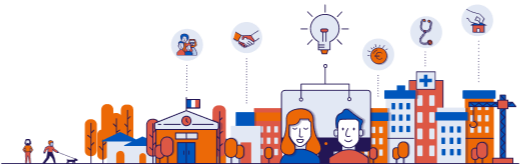




































![[ép. 205] Qualité de l'eau : alerte générale](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2024/10/ep-205-qualite-de-l-eau-alerte-generale-300x161.png)
![[ép. 204] Droit au silence et sanctions : qu'est-ce qui change ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2024/10/ep-204-droit-au-silence-et-sanctions-qu-est-ce-qui-change-300x161.png)
![[ép. 203] L'acheteur public doit-il être muet?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2024/10/ep-203-l-acheteur-public-doit-il-etre-muet-300x161.png)


