Consulter le sommaire :
- Le fonctionnement de l'EPLE
- Connaître son environnement professionnel
- Accueillir les élèves à besoins particuliers
- Vie scolaire et fonction CPE
- Connaître son sujet
- Surveillance des élèves et régime disciplinaire
- Jouer son rôle dans l'équipe éducative
- Éducation à la citoyenneté et animation socio-éducative
- Partenariats et ouverture de l'établissement
- La communication au cœur de la vie scolaire
- Décentralisation et autonomie de l'EPLE
- Projet d'établissement et contrat d'objectifs
- Les conseils de l'EPLE
- L'équipe d'encadrement
- Le collège du socle commun
- Le lycée d'enseignement général et technologique
- Le lycée professionnel
- Accueillir les élèves en difficulté
- Scolariser les élèves en situation de handicap
- Réinsérer les élèves difficiles
- Les modalités de l'éducation prioritaire
- Espace et temps scolaires
- Devenir CPE
- Identité professionnelle du CPE
- Piloter l'équipe vie scolaire
- Numérique et vie scolaire
- Des adolescents
- Des jeunes
- Des élèves
- Contrôle des absences et lutte contre l'absentéisme
- Régime disciplinaire, sanctions et punitions
- Gestion des entrées, sorties, internat, demi-pension
- Sécurité et lutte contre la violence
- Le CPE dans l'équipe éducative
- Aider et accompagner les élèves
- Évaluation et orientation des élèves
- Faire respecter la discipline dans la collectivité
- Actions éducatives
- Éduquer à la santé et à la sexualité
- Les relations avec les milieux professionnels
- Sorties et voyages scolaires
- Réussite éducative et politique de la ville
- Les partenariats fonctionnels
- Les relations avec les parents d'élèves
- L'ouverture internationale
- Mener des entretiens professionnels
- Animer un groupe, conduire une réunion
- Méthodes et outils pour communiquer
- Gestion de conflits
Faites votre choix en
colonne de gauche

Faites votre choix en
colonne de gauche


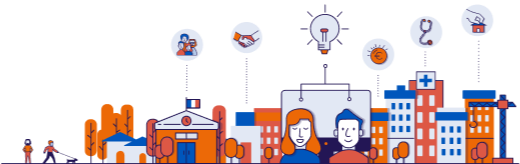





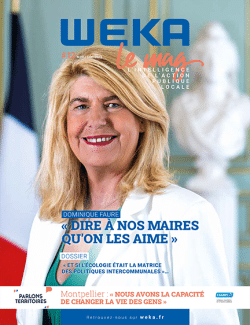























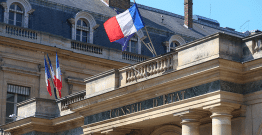






![[ép. 188] Piloter, en tant qu'élu, un projet sensible : conseils opérationnels](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2024/05/ep-189-piloter-en-tant-qu-elu-un-projet-sensible-conseils-operationnels-300x161.png)
![[ép. 187] Le projet de loi de simplification](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2024/04/ep-187-le-projet-de-loi-de-simplification-article-300x161.png)

