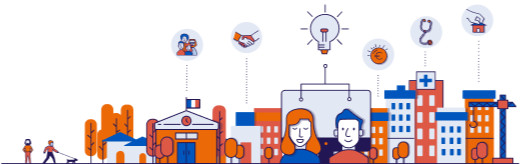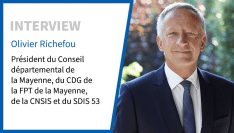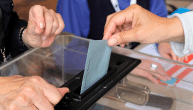Lors du dernier Congrès des maires (17 au 19 novembre 2025), vous avez insisté sur le fait qu’il était nécessaire, pour l’ensemble des acteurs intervenant dans le secteur de la pauvreté, de mieux travailler ensemble. Vouliez-vous dire que ce n’est pas le cas ?
Je constate que nous sommes souvent en situation de confrontation parce que malgré la contractualisation et les pactes, d’un côté il y a l’État et de l’autre, les élus. Or, il est évident à mes yeux que chaque fois que nous dépassons cette opposition, nous parvenons à réussir des choses très utiles aux personnes en situation de pauvreté. Nous sommes « condamnés », je pose de gros guillemets dans cette affirmation, à travailler ensemble, à travers des diagnostics partagés et en évaluations communes. Or, le paysage de nos organisations institutionnelles est construit de telle manière que nous sommes souvent en silo. Mais dans le travail réel avec les collectivités, ça se passe beaucoup mieux que sur les estrades de colloques, où chacun adopte une posture. D’ailleurs, après le Congrès des maires, certains d’entre eux ont pris contact avec moi pour que nous envisagions de travailler ensemble.
Faut-il changer de méthode de travail ?
Beaucoup d’élus locaux nous disent qu’ils ont besoin de plus de moyens financiers. Je n’en doute pas. Mais déjà, essayons de mieux travailler ensemble parce que je me rends compte qu’il y a beaucoup de déperditions. Or, nous disposons en matière de solidarité du système européen le plus redistributif. Sur la contractualisation avec les collectivités dans le cadre du pacte des solidarités, l’ensemble des crédits mis à disposition n’est pas toujours entièrement consommé. Cela ne signifie évidemment pas que les besoins n’existent pas, mais que nous devons nous interroger sur les freins à la mobilisation de ces moyens. Pourquoi réclamer plus de moyens financiers alors que ceux qui sont disponibles ne sont pas consommés ?
Sur les arbitrages budgétaires, avez-vous pu sauver l’essentiel ?
Nous avons réussi à tout sauver. Sans oublier de nouvelles mesures grâce à l’adoption du budget 2026, comme la prime d’activité pour tout le monde, 50 euros de plus, ce n’est pas rien quand on est dans la difficulté. Je pense aussi au repas à un euro pour tous les étudiants. Le Pacte des solidarités est sacralisé dans sa trajectoire.
Pouvez-vous nous décrire en quelques mots la philosophie de ce pacte des solidarités et ses conséquences concrètes ?
Le Pacte des solidarités n’est pas une accumulation de dispositifs : c’est un cadre commun qui construit des liens en mobilisant et reliant tous les acteurs. Il veille à ce que les actions atteignent réellement les personnes concernées. C’est avant tout un cadre général mais non exhaustif pour lutter contre la pauvreté. Il a été pensé en trajectoire de 2024 à 2027 et nous en lançons d’ailleurs actuellement l’évaluation. Ce pacte se décompose en mesures nationales portées par différents ministères pour agir nationalement et en cohérence sur les principaux enjeux de la pauvreté. Il inscrit aussi la dimension territoriale en permettant une contractualisation à parité de financements entre l’État et les conseils départementaux et métropoles volontaires. Là encore, on recherche la cohérence, l’innovation et les réponses adaptées et efficaces. Enfin, le Pacte des solidarités, c’est aussi, grâce aux pactes locaux des solidarités, la possibilité à l’échelle des bassins de vie de créer des dynamiques locales sur la base d’un diagnostic et d’un engagement d’acteurs différents : communes, intercommunalités, entreprises, etc. Les acteurs mutualisent compétences et moyens pour traiter de façon très concrète, très opérationnelle et facilement mesurable, les problèmes des personnes ciblées : jeunes, familles monoparentales, travailleurs pauvres, par exemple.
Pourquoi avoir décidé de lancer cette étude sur la ruralité et les diverses formes de pauvreté qui s’y manifestent ?
C’était un angle mort. Bien sûr. Il y a plus de personnes pauvres dans les quartiers politique de la ville. La pauvreté touche néanmoins aussi les ruraux, notamment les néoruraux dont on parle de plus en plus. C’est une pauvreté plus cachée, les gens se déclarent moins, ils sont donc de ce fait moins accompagnés. Dans les quartiers politique de la ville, le tissu associatif est plus dense, il est plus facile de trouver des réponses aux problèmes. C’est moins le cas dans le rural, où les typologies de la pauvreté sont différentes. On trouve par exemple des propriétaires pauvres. Vous pouvez aussi être confronté à des dépenses contraintes, des frais de garde, de véhicule, de déplacement et d’énergie. Ces difficultés sont moins visibles, elles sont peu portées par les associations parce qu’elles sont moins présentes en ruralité. France Services répond à l’éloignement des services publics mais nous avons considéré qu’il fallait mieux connaître ces difficultés en associant des acteurs qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble, dans une logique de co-construction, pour mieux objectiver ces réalités et surtout mieux y répondre.
Vous insistez aussi sur le fait de lutter contre la stigmatisation de cette population-là…
Ce sont en effet, souvent, des personnes qui ne veulent pas dire qu’elles sont pauvres. Ce qui entraîne un phénomène de non-recours aux droits existants parce qu’on craint que dans le village on vous colle l’image de « l’assisté ». Dans le même temps, et c’est paradoxal, on développe un sentiment d’abandon et de défiance vis-à-vis des services publics.
Quelles sont les initiatives dans le rural qui permettent de sortir de cette spirale ?
Je pense notamment à Bouge ton coq qui crée des épiceries associatives ouvertes à tous sans discrimination, à partir du moment où vous habitez le village. Les prix sont de 30 à 40 % moins chers parce que les épiceries sont alimentées par une centrale d’achats et des producteurs locaux. Il ne s’agit pas de proposer une épicerie « pour les pauvres » où les gens n’iront pas par peur du regard du voisin. Ce sont précisément ce type d’initiatives que nous voulons encourager.
La démarche d’« aller vers » est-elle en place dans le rural ?
C’est une démarche qui se répand de plus en plus. Mais l’idée, pour éviter toujours cette stigmatisation, c’est de proposer des initiatives qui profiteraient à tout le monde, même si, en fait, les personnes les plus défavorisées en seraient les principales bénéficiaires. Je sais que Michel Fournier, ministre de la Ruralité, y est très attaché. C’est pour cette raison que nous travaillons beaucoup avec l’ANCT pour que chaque opération de revitalisation intègre à chaque fois la dimension sociale. C’est relativement nouveau, on a eu un peu tendance ces dernières années à travailler le développement économique et l’aménagement du territoire indépendamment de la dimension sociale.
Faut-il imaginer une nouvelle approche de la pauvreté en milieu rural, qui prendrait la forme d’une loi, par exemple ?
Il ne faut rien s’interdire en termes de leviers mais je crois beaucoup à une approche volontaire. Prenons l’éducation. Les jeunes ont parfois du mal à imaginer leur ambition scolaire en dehors de leur territoire, par attachement à leurs racines et par difficultés matérielles. Certains restreignent cette ambition parce que partir, ne serait-ce qu’à 50 kilomètres du lieu d’habitation, c’est compliqué, inquiétant et cher, avec ce conflit de loyauté vis-à-vis de la famille, du village. Dans les années 70, l’exode rural était synonyme d’ascension sociale ; aujourd’hui, c’est moins le cas. On pourrait imaginer des choses simples comme des jumelages d’établissements, entre un collège de centre-ville d’une grosse commune avec un autre dans le rural. En fait, les idées sont là et comme je le dis souvent, au-delà des moyens financiers, qui sont évidemment importants, ce qu’il manque le plus souvent, ce sont des coordinations d’acteurs qui permettent, quand elles atteignent un bon niveau d’efficacité, de trouver des solutions.
Stéphane Menu
1. « Pauvreté en milieu rural : regards croisés et pratiques inspirantes », Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, janvier 2026