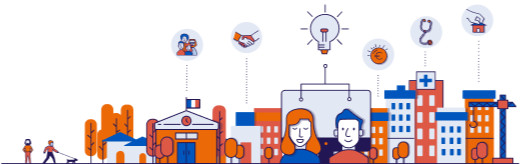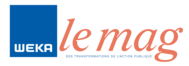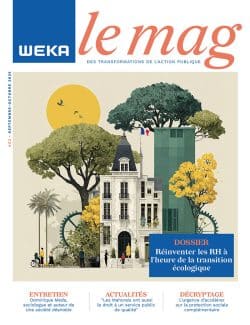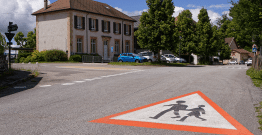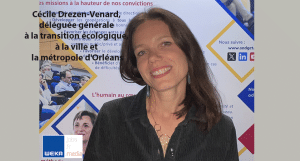Partie 2 - Les méthodes, techniques et outils
Chapitre 1 - Processus et méthodologie de veille
2.1/16 - Pratiquer la veille stratégique et l'intelligence économique en PME et en TPE
I - Introduction et état des lieux
En dépit des idées reçues, il existe des PME et même des TPE pratiquant l'intelligence économique (IE). Ce qui diffère, par rapport à une grande entreprise, ce sont les moyens mis en œuvre. Il en va de l'IE comme des autres fonctions de l'entreprise (RH, marketing, etc.) : une PME peut très bien la pratiquer de façon relativement informelle. L'attitude du chef d'entreprise est donc déterminante : s'il est convaincu que la pratique de IE peut aider son entreprise à être plus performante, il sera le mieux placé pour adapter les grands principes décrits dans cet ouvrage à son organisation. En premier lieu, il sera bien avisé d'entreprendre une démarche de la veille stratégique, porte d'entrée vers l'IE.
Pour préserver l'anonymat des entreprises, les noms des PME citées ont été changés.
Si dans les années 1990, on pensait que l'IE était une affaire réservée aux grandes entreprises, voire aux multinationales appartenant à des secteurs stratégiques pour l'État (défense, nouvelles technologies, énergie, etc.), ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il en va en effet de l'IE comme de toutes les pratiques organisationnelles : les différences entre une petite et une grande entreprise, entre une entreprise privée et une entreprise publique, entre une entreprise, une ONG, une collectivité territoriale, voire un État sont bien souvent de degré, pas de nature. Toutes ces organisations pratiquent des formes de marketing, de gestion des ressources humaines, de planification, de comptabilité, etc. Toutes sont susceptibles de pratiquer l'IE. Simplement, leurs moyens, leurs objectifs et leurs méthodes différeront. Ce n'est pas parce que l'IE n'est pas incarnée dans un organigramme ou matérialisée par un coûteux système d'information dédié qu'elle n'est pas pratiquée. Elle n'a même pas besoin d'être nommée pour l'être : certains patrons de PME la pratiquent sans le savoir. La première chose à faire pour une PME qui souhaite s'approprier une démarche d'IE est donc d'oublier définitivement la phrase « ce n'est pas à notre portée ».
Tous les principes généraux et nombre d'outils décrits dans les chapitres de cet ouvrage peuvent s'appliquer en PME. L'IE, dans une petite structure, consiste tout autant que dans une grande à faire de la veille, à protéger son patrimoine informationnel et à tenter d'influencer son environnement plutôt que de le subir. Tout cela est possible sans infrastructure lourde et sans moyens financiers importants.