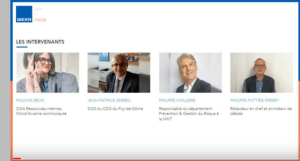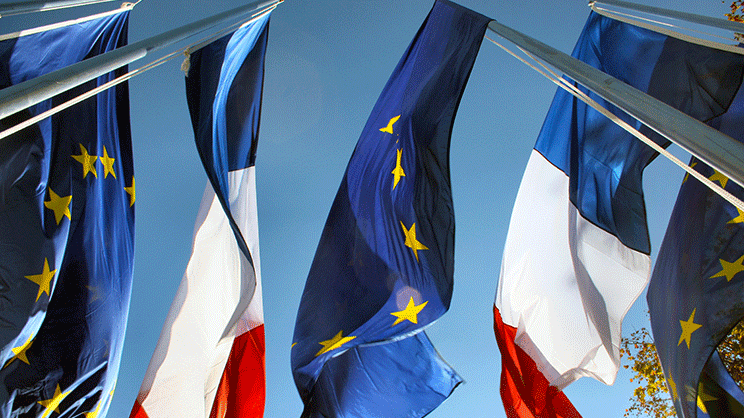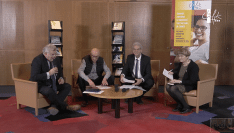Dans l’optique des élections européennes du 9 juin 2024, le think tank Le Sens du service public livre les réflexions de plusieurs experts sur l’organisation et l’avenir des services publics dans l’Union européenne*. Quinze propositions visent à établir des principes communs.
« L’Union européenne (UE) n’appréhende pas les services publics comme la France, avec la notion d’intérêt général. {…} Peu importe celui qui délivre la mission, ce qui compte, c’est la nature même de cette mission, en distinguant ce qui relève de la logique du marché et ce qui peut y être soustrait », précise le rapport en introduction. Seuls les services d’intérêt économique général (SIEG) font l’objet d’un encadrement spécifique de l’UE. Il s’agit des activités économiques remplissant des missions d’intérêt général qui ne seraient pas exécutées – ou qui le seraient à des conditions différentes par le marché en l’absence d’une intervention de l’État.
Les activités relevant de la puissance publique ne sont donc pas considérées comme des activités économiques et se situent en dehors du champ du droit européen ; mais la Cour de justice apprécie le caractère économique au cas par cas.
« Il n’existe pas un modèle de fonction publique ou de services publics au sein de l’Union européenne, alors même que le cadre normatif européen y est identique », précise Émilie Agnoux, co-fondatrice du Sens du service public. L’UE fixe des principes mais chaque pays membre a son propre modèle d’organisation, d’où une grande complexité. Pour que cela change, il faudrait que les trois plus grands États (Allemagne, France, Italie) s’accordent déjà « sur un modèle d’administration partagé suffisamment attractif pour rallier les autres », constate Jean-Michel Eymeri-Douzans, professeur de science politique et directeur adjoint de l’Institut d’études politiques de Toulouse. En Allemagne (pays fédéral), la fonction publique fédérale est réduite et les administrations des Länder (régions) ont un rôle beaucoup plus important que les conseils régionaux et départementaux français. Quant à l’Italie, depuis près de vingt ans, la plupart des salariés publics sont sous un régime de contrat de travail et conventions collectives.
La fonction publique européenne s’est construite au croisement entre les modèles français et allemand, dans les années 1950-1960. Même s’il est difficile de se projeter vers un modèle administratif européen commun, Jean-Michel Eymeri-Douzans imagine que l’UE pourrait développer un modèle plus ambitieux, en partant des grands enjeux : écologie, numérique, big data, IA… Le pilotage de ces transitions prendra au moins quarante ans, une « durée à la mesure des carrières de fonctionnaires ».
Pour sa part, Luc Rouban, directeur de recherche CNRS au Cevipof** analyse la spécificité de l’administration française et ses perspectives d’évolution. Il rappelle qu’avec le principe de subsidiarité, les États membres sont libres de l’organisation et du fonctionnement de leurs services publics, à condition de respecter les règles libérales de l’UE : libre circulation des travailleurs, ouverture de l’offre de service public.
Il pointe notamment la « prédilection » de la haute fonction publique française pour le modèle allemand », qui « distingue les vrais fonctionnaires titulaires, affectés aux tâches régaliennes (police, magistrature…) des autres agents publics recrutés et gérés sur la base de contrats de droit privé ». Les « élites dirigeantes » peuvent ainsi assouplir le fonctionnement des services publics, par des licenciements économiques que le statut général ne permet pas, et en maintenant la distance sociale entre ceux qui décident et ceux qui exécutent. Ce qui est « dangereux lorsque l’on ne maîtrise aucune professionnalité en haut et que la forte technicité du bas n’est pas reconnue ».
Ainsi, la seule véritable européanisation des fonctions publiques a été réalisée sous l’influence du modèle allemand, poursuit Luc Rouban. Réformer la fonction publique ne peut pas s’appuyer sur des modèles européens importés, qui s’inscrivent dans des logiques très différentes. Il conviendrait d’abord de travailler sur l’attractivité des métiers, en valorisant l’expérience davantage que les diplômes, à tous niveaux de responsabilité. Il faudrait aussi « promouvoir réellement le modèle républicain qui implique par définition une règle d’équité ».
S’appuyant sur le baromètre de la confiance politique, publié par le Cevipof en février 2024, il estime qu’une réforme doit permettre, à la fois, des mobilités professionnelles aujourd’hui très difficiles, et une reconnaissance du travail accompli. Ce qui, dans un contexte européen, amène vers la contractualisation et la privatisation de la relation d’emploi comme cela existe dans de nombreux pays. Si l’on cherche à préserver le statut, « marqueur d’engagement sociopolitique au service de l’intérêt général », il faudra procéder à une vaste décentralisation et rendre les établissements qui emploient les fonctionnaires autonomes et libres du recrutement et de l’avancement. Il faudra également supprimer tous les mécanismes qui nuisent à l’image de la fonction publique.
Martine Courgnaud – Del Ry
* Rapport coordonné par Émilie Agnoux et Laure de la Bretèche, publié en mai 2024 en partenariat avec la fondation Jean Jaurès.
** Centre de recherches politiques de Sciences Po.

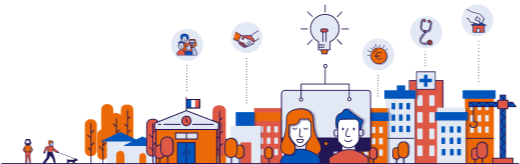




































![[ép. 198] Communes nouvelles : quelle relance ? Commune-communauté : quel lancement ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2024/07/ep-198-communes-nouvelles-quelle-relance-commune-communaute-quel-lancement-1-300x161.png)
![[ép. 197] Formations dans les IRA, carrières des attachés d'administration de l’État, actions de l’AAEIRA](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2024/07/ep-197-article-formations-dans-les-ira-carrieres-des-attaches-d-administration-de-l-etat-actions-de-l-aaeira-300x161.png)