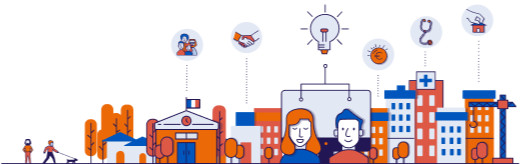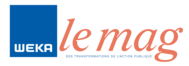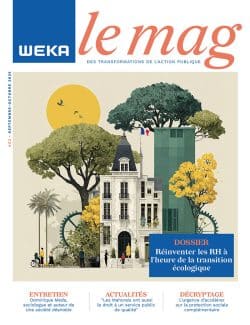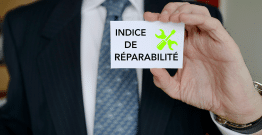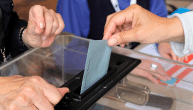La proposition de loi transpartisane du 27 mars 2025 du sénateur LR Rémy Pointereau visant à renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation afin d’adapter les normes aux territoires a été adoptée mardi 10 juin au Sénat. Dans la foulée des assises de la simplification lancées le 3 avril dernier par le Premier ministre, François Rebsamen, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, vient lui début juin d’appeler par circulaire les préfets à simplifier l’action des collectivités territoriales.
« Chacun essaie de trouver sa solution », analyse Gilles Noël, président des maires ruraux de la Nièvre et présent à ces assises. Les textes se succèdent en effet : les deux rapports 2013 et 2017 de la mission de lutte contre l’inflation normative de Jean-Claude Boulard et Alain Lambert, la charte signée par le gouvernement et le Sénat le 16 mars 2023 pour la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Mais les préconisations faites alors n’ont été que peu suivies d’effet.
Utiles conférences de dialogue ?
Certes, la charte a permis que le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) transmette systématiquement l’ordre du jour et ses relevés à la délégation du Sénat aux collectivités territoriales. La cellule Cassiopée, créée en 2024, relaye quant à elle aux commissions permanentes les avis défavorables du CNEN. Certes, depuis le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 (article 1), « le préfet de région ou de département peut déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence » dans certains domaines1. Mais de fait, seul 1,5 arrêté par département a été pris depuis. Il faut dire que « le préfet anticipe le risque juridique d’être contesté par une association, un collectif… », note Rémy Pointereau. Sans oublier « la peur que si l’on parle, on nous freine notre projet », selon Gilles Noël qui regrette qu’une réunion de formation par arrondissement n’ait alors pas eu lieu. Il faut bien comprendre aussi que certains préfets sont plus « zélés » que d’autres : « Tel préfet sera capable face à ses services de dire : ‟Faites qu’en deux ans, cette situation ne perdure pasˮ, mais tel autre voudra régler l’affaire tout de suite au tribunal administratif pour être en règle, quitte à faire fermer un service communal et à mettre des personnes au chômage », assure Gilles Noël. Dans le Loir-et-Cher toutefois, une dérogation préfectorale a permis à une commune d’aller au-delà des 80 % de subventions pour un projet ; dans le Lot, la préfète a assoupli le nombre d’animateurs requis pour tant de mineurs, pour éviter l’annulation d’un accueil de mineurs. « Il faut aller plus loin, assure Rémy Pointereau. La PPL déroge ainsi au Code de l’environnement pour permettre la conservation de tel moulin patrimonial sans impact réel sur la circulation de l’eau ».
En tout cas, l’article 1 de la PPL répète l’article 1 du décret cité, précisant juste les objectifs pour les collectivités locales : « faciliter la conduite des projets locaux », « alléger le poids des normes sur les finances locales ». L’article 2 permet, lui, au préfet d’accorder des dérogations à la règle du 20 % minimal pour le financement de tout projet de collectivité locale, notamment en cas de contribution disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d’ouvrage… souvent liée aux normes. Avec l’article 4, le préfet peut prévoir « des délais pour la mise en conformité des installations existantes au regard notamment de l’importance des travaux nécessaires et des capacités financières des collectivités territoriales », ceci notamment pour éviter les excès de pouvoir des fédérations sportives « imposant aux collectivités qui payent d’aménager stades et vestiaires en fonction des montées en ligues de tels clubs », selon Rémy Pointereau. Enfin, c’était préconisé dès 2013, l’article 5 de la PPL prévoit une conférence de dialogue en préfecture pouvant notamment :
- émettre des avis sur un arrêté préfectoral de dérogation aux normes, sur des cas complexes d’interprétation des normes ;
- identifier des difficultés locales en la matière et les porter à connaissance de l’État ;
- formuler des propositions de simplification.
Mais cela a déjà été tenté sous Michel Barnier : « Les préfets devaient remonter des situations où la complexité administrative devait être simplifiée. Ils ont fait appel aux associations d’élus qui n’ont rien trouvé. Les élus ont peur que l’administration leur rétorque que leur projet est impossible », observe Gilles Noël. De toute façon, ces circuits longs avec des services préfectoraux et territoriaux déjà surchargés peuvent-ils aboutir ? Surtout, n’est-ce pas plutôt à l’État de ne pas provoquer l’inflation des normes ?
Ligne rouge de l’abrogation
D’autres actions ne sont-elles pas plus urgentes ? François Hollande annonçait en 2013 que « toute nouvelle norme devait entraîner la suppression d’une norme existante ». Quant aux abrogations ou adaptations pour simplifier la vie des élus locaux ou au conseil en interprétation en lieu et place du contrôle de légalité déjà demandés en 2013, rien n’a été fait depuis. Guy Geoffroy, président des Maires de Seine-et-Marne, cite deux exemples, celui des panneaux à implanter sur sites pour diverses raisons et dont le nombre s’amplifie, et celui des études écologiques à faire sur quatre saisons : « Oui dans certains cas, mais le côté systématique est gênant ».
Gilles Noël se rappelle lui, lorsqu’il a rénové un ERP avec ses chambres : « En début de travaux, on nous a expliqué qu’il fallait un système de tel niveau en matière de sécurité pour accueillir du public, mais la commission de sécurité lors du contrôle des travaux nous a signifié que les normes ayant changé, il fallait alors un système un cran plus élevé. Il a donc fallu racheter du matériel et repayer l’organisme de contrôle… En Suisse, la norme applicable est celle en vigueur au début des travaux ».
Des situations ubuesques étant bloquées, on en vient à remercier certains élus de préserver le bon sens… et l’argent public. Faire une petite rampe de 5 mètres de long pour accéder à l’église du village à 5 000 € au lieu de celle en béton de 20 mètres initialement demandée pour valider le permis de construire et défigurant le monument à 20 000 € n’est-il pas être responsable plutôt que coupable pour ce maire ? Idem pour un maire qui refuse pour sa commune de 360 habitants d’installer quatre toilettes différentes (une pour femmes, une pour hommes, une pour femmes PMR et une pour hommes PMR) et en installe finalement deux : une pour hommes PMR et une pour femmes PMR.
Ne pourrait-on pas plutôt condamner l’administration pour de tels abus et non les élus ? Tout le monde en rêve, mais personne n’ose franchir cette ligne rouge de l’abrogation, la PPL ne change rien à cela. Au mieux, certains textes ne sont parfois pas adoptés, comme « ce projet de décret en Conseil d’État qui nous aurait appris à nous, élus et services, comment installer des sas vélos devant les feux rouges ! selon Guy Geoffroy. Heureusement, il a été renvoyé sèchement par le CNEN ».
« Il faudrait un projet de loi du gouvernement »
Pour Gilles Noël, « l’administration a un tel pouvoir que cela continue malgré le volontarisme des élus. L’administration interprète – par des décrets, des arrêtés… Exemple ? Alors que la loi 3DS avait prévu une gouvernance des Agences régionales de santé enrichie de la présence d’élus locaux, un arrêté a restreint cette présence aux élus AMF. Les politiques se sont fait doubler. Résultat, les communes rurales n’ont pas eu leur mot à dire ». Pour Guy Geoffroy, cet échec vient d’une décentralisation qui n’a pas réussi « à octroyer un véritable pouvoir réglementaire local et une véritable déconcentration, c’est-à-dire à renforcer la position du préfet dans le département. D’où un engorgement des préfectures, l’État devant s’occuper de tout ». Pour lui, « la PPL va essayer de corriger quelques conséquences, alors qu’il faudrait un projet de loi du gouvernement pour corriger les causes. Il y a urgence : un projet mettait quatre ans à sortir entre l’idée et l’inauguration, c’est désormais 6 ou 7 ans… ».
La PPL risque bien d’être un coup d’épée dans l’eau, alors que le coût des normes pour les collectivités territoriales est estimé à 2,5 Mds€/an. Sans parler de l’impact sur les vocations d’élus : « 2 % des communes ont changé de maire sur le mandat 2008-2014, 6 % en 2010-2020 et 11 % en 2020-2025. Technocratisation et politisation ne sont pas bon signe », tance Guy Geoffroy. Lutter contre l’inflation des normes, c’est aussi du réalisme.
Frédéric Ville
| 47 à 50 projets de loi par an sortent chaque année en France, contre une quinzaine par an en moyenne dans les autres pays européens (source : Rémy Pointereau, sénateur). |
1. Aménagement du territoire, politique de la ville ; environnement, agriculture et forêt ; construction, logement et urbanisme ; emploi et activités économiques ; protection et mise en valeur du patrimoine culturel ; activités sportives, socio-éducatives et associatives.