CDD fonction publique
CDD fonction publique dans l'actualité
-
Article
“Il n'y a pas de réussite possible dans la fonction publique si…
Ancien ministre de la Fonction publique de 1981 à 1984, Anicet Le Pors a apporté son témoignage le 8 octobre 2021, lors d'une table ronde* sur le "service public territorial en 2030". -
Article
Fonction publique : 19,2% de contractuels fin 2018 dont 57% en CDD
La part des contractuels dans la fonction publique continue d'augmenter et atteignait 19,2 % des effectifs (+ 0,8 point par rapport à fin 2017) fin 2018, selon… -
Article
Contrat de projet : création d’un nouveau type de contrat en CDD…
Les modalités de mise en œuvre du contrat de projet créé au sein des trois versants de la fonction publique pour les catégories A, B et C sont définies par un décret… -
Article
Nouvelles dispositions RH dans la fonction publique : publicité des stages, négociation…
Une rencontre entre la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et la coordination des employeurs territoriaux, créée à l'initiative du CSFPT,…
CDD fonction publique dans les ressources documentaires

Le Conseil commun de la fonction publique et le Conseil…
27/02/2022

Organisation de la fonction publique territoriale
02/02/2022

Le contrat à durée déterminée (CDD) dans la fonction publique…
15/01/2024

Les administrations centrales en charge de la fonction publique hospitalière
17/07/2014

Le nouveau Code général de la fonction publique
09/05/2023

La négociation et les accords collectifs dans la fonction publique
17/01/2022

Le temps de travail dans la fonction publique territoriale
28/03/2024

Sources du droit de la fonction publique hospitalière et hiérarchie…
22/03/2022

Comment autoriser le cumul d’activités dans la fonction publique hospitalière…
03/12/2023

Appréhender la réforme de la fonction publique
06/11/2023

L’intégration directe dans la fonction publique hospitalière en cas de…
27/02/2022

La vérification de l’aptitude physique lors d’un recrutement et/ou d’une…
17/04/2023

La mobilité pour les agents de la fonction publique
24/01/2022
Une offre pour chaque métier
Les + vus

21/03/2023
Fonction publique hospitalière : quelle rémunération le 1er mai ?

15/04/2024
Réforme de la fonction publique : ce que proposent les directeurs de ...
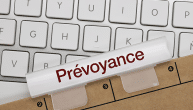
30/04/2024
Le gouvernement valide un accord sur la prévoyance des fonctionnaires

29/04/2024
Faut-il analyser les offres avec ou sans TVA ?

02/04/2024
Semaine de 4 jours dans la fonction publique : l'expérimentation ...

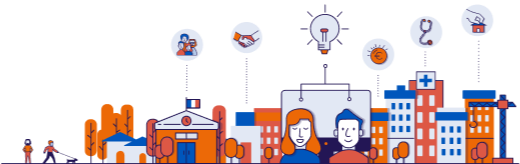





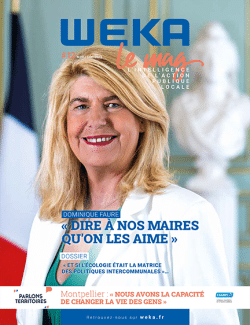





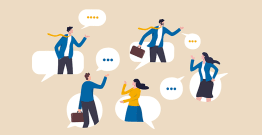
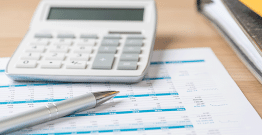















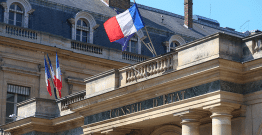







![[ép. 187] Le projet de loi de simplification](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2024/04/ep-187-le-projet-de-loi-de-simplification-article-300x161.png)








